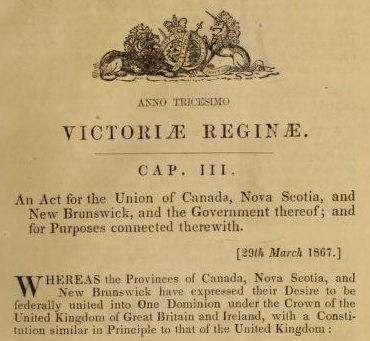Au dernier cours, nous avons parlé des règles formelles qui encadrent la nomination du premier ministre du Québec, pour en arriver à la conclusion qu’il y en a une seule: le lieutenant-gouverneur décide. Nous discuterons donc aujourd’hui des autres règles, non écrites celles-là, qui guident la décision de la personne qui représente la Reine.

Comme l’actualité nous a rattrapés, nous laisserons notre ami Tuan à son étude des textes constitutionnels et nous nous transporterons plutôt dans le bureau de la lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick, l’honorable Jocelyne Roy Vienneau. Elle recevait mardi matin la visite du premier ministre (sortant) et chef du parti libéral de la province, le tout aussi honorable Bryan Gallant.
(Au passage, mentionnons que nous sommes d’avis que l’accord au féminin «lieutenante-gouverneure» rend la prononciation désagréable, mais nous suivons en ce sens la pratique du gouvernement du Nouveau-Brunswick.)
La rencontre
Mardi matin donc, la lieutenante-gouverneure sirote tranquillement son thé vice-royal. Elle s’est couchée tard la veille parce que la soirée électorale a été longue, les résultats étant très serrés (un scénario qui pourrait très bien se produire au Québec, si on se fie à mon ami Raphaël Crevier).
La nouvelle répartition des sièges à l’assemblée législative est la suivante:
| Nb de sièges | |
|---|---|
| Parti progressiste-conservateur | 22 |
| Parti libéral | 21 |
| Alliance des gens du Nouveau-Brunswick | 3 |
| Parti vert | 3 |
| Seuil pour obtenir une majorité | 25 |
Source: «Résultats non officiels». Elections NB, 24 septembre 2018.
(Le parti Kiss du Nouveau-Brunswick n’a remporté aucun siège avec ses 336 votes, mais à défaut de connaître leurs positions, on aime bien leur nom.)
C’est alors qu’on annonce l’arrivée du premier ministre Gallant. Malheureusement, nous ne pouvons pas savoir ce qui s’est dit entre les deux honorables dans l’intimité du bureau mais, selon ce qui a été rapporté dans les médias, voici à peu près de dont ça devait avoir l’air:
- L’hon. Bryan Gallant:
- Votre honneur, je vous annonce que j’ai l’intention de continuer à diriger le gouvernement de la province.
- L’hon. Jocelyne Roy Vienneau:
- Fort bien, monsieur le Premier ministre, mais avez-vous toujours la confiance de l’assemblée législative?
- B.G.:
- Je le crois, mais je n’en suis pas totalement sûr.
- J.R.V.:
- Alors, revenez me voir quand vous saurez quoi me dire et, d’ici là, arrêtez de me déranger!
La lieutenante-gouverneure a ensuite reçu la visite du chef du parti progressiste-conservateur, Blaine Higgs, et on ne sait pas plus ce qui s’est dit mais, comme la province avait toujours un premier ministre à ce moment-là, c’est de peu d’intérêt.
Nous en sommes là.
Quels étaient les scénarios possibles?

La lieutenante-gouverneure aurait pu destituer le premier ministre Gallant. Formellement, elle en a le pouvoir. Toutefois, le dernier lieutenant-gouverneur qui s’est essayé a été lui-même destitué quelques mois plus tard, à cause de sa décision controversée.
C’était toutefois en 1878: Luc Letellier de Saint-Just a destitué le premier ministre conservateur du Québec, Charles-Eugène Boucher de Boucherville. En 2018, à moins d’une crise constitutionnelle majeure (par exemple, si un premier ministre qui a perdu la confiance de l’assemblée refusait de démissionner), on oublie ça.
Le premier ministre aurait pu remettre sa démission. C’est, par exemple, ce que Jean Charest avait choisi de faire après avoir vu son parti arriver deuxième en nombre de sièges aux élections québécoises du 4 septembre 2012.
Il aurait pu au contraire essayer d’obtenir le soutien des députés de la Coalition avenir Québec (CAQ) pour conserver la confiance de l’assemblée, même si le Parti québécois avait remporté deux sièges de plus.

Le premier ministre peut choisir de rester en poste et tenter d’obtenir (ou plutôt, de maintenir) la confiance de l’assemblée législative. C’est ce qu’a choisi de faire la libérale Christy Clark après les élections britanno-colombiennes du 9 mai 2017.
Ses espoirs ont cependant été de courte durée, puisque l’assemblée législative a adopté une motion de censure pour retirer sa confiance à la première ministre le 29 juin de la même année, la poussant à démissionner.
Un petit mot au passage sur l’affirmation de Brian Gallant comme quoi il aurait obtenu la «permission» de la lieutenante-gouverneure pour rester en poste. Formellement, il n’avait aucune permission à demander, étant toujours le premier ministre en poste. Tout ce qu’on peut comprendre, c’est que la lieutenante-gouverneure ne l’a pas destitué et n’a pas demandé sa démission.
Mais qu’est-ce qui guide les décisions de la lieutenante-gouverneure? C’est le moment d’aborder les conventions constitutionnelles en commençant par les distinguer d’autres notions voisines.
Conventions, coutume et common law…
Question de placer les concepts, j’aimerais revenir sur une intervention de l’élève Rodrigue Desnoyers, dans un commentaire émis lors notre dernier cours, qui fait référence à des concepts voisins de la convention constitutionnelle :
Oui mais il y a le droit coutumier si cher aux Brits. C’est aussi le principe du “Common Law”. Alors, ne vous souciez pas. Le premier ministre est le chef du parti porté au pourvoir par l’élection.
Dans son intervention, monsieur Desnoyers utilise deux concepts que je tenterai de définir et de distinguer de la notion de convention constitutionnelle.
Common law
Tout d’abord, la common law est un système juridique où les règles de droit sont principalement issues des décisions des tribunaux, et où le droit se développe au fur et à mesure des décisions individuelles.
Dans un système de common law, les parlements votent bien sûr des lois, mais celles-ci viennent s’ajouter de façon ponctuelle au «socle» que constituent les décisions des tribunaux.
Par opposition, dans un système civiliste, c’est le contraire: la loi (au premier chef, le Code civil) constitue la base du droit, et la jurisprudence ne s’y ajoute que pour l’interpréter et combler ses vides.
Au Québec, nous avons un système mixte: civiliste en droit privé (les relations entre les individus) et de common law en droit public (les relations entre l’individu et l’État; par exemple, le droit criminel).
Il n’en demeure pas moins que, dans un système de common law, les règles sont développées par les tribunaux et, surtout, susceptibles d’être appliquées et sanctionnées par les tribunaux. C’est du droit formel, au même titre que les lois écrites.
Coutume
Ensuite, la coutume désigne toute règle de conduite qui s’appuie sur un usage constant et répété. Il ne s’agit pas toujours de règles juridiques. Par exemple, si vous jouez aux cartes dans votre famille avec des règles qui ont été transmises de génération en génération sans jamais être écrites, vous être probablement en présence d’une coutume.

L’existence d’une règle coutumière exige non seulement un usage constant et répété, mais aussi que celles et ceux qui sont visés soient convaincus de son caractère obligatoire.
Aujourd’hui, la coutume n’est susceptible d’être sanctionnée par les tribunaux que lorsque la loi écrite le prévoit, par exemple en matière de contenu d’un contrat. (Dans un domaine spécifique, les usages peuvent faire partie du contenu d’un contrat sans qu’il soit nécessaire de le prévoir explicitement, selon l’article 1434 du Code civil.)
Conventions constitutionnelles
Enfin, les conventions constitutionnelles sont en quelque sorte le sous-ensemble des règles coutumières qui concernent spécifiquement le fonctionnement de nos institutions politiques. L’existence d’une convention constitutionnelle nécessite donc une pratique constante et le sentiment des acteurs politiques d’y être liés.
Certains experts ajoutent qu’une convention constitutionnelle doit être appuyée sur un grand principe de gouvernance, tel que la démocratie représentative, bref avoir une raison d’être. Comme il s’agit uniquement de règles coutumières, à moins d’être incorporées dans une loi, les conventions constitutionnelles ne sont pas susceptibles d’être sanctionnées par les tribunaux. C’est le comportement des acteurs et le sentiment d’être lié qui leur donnent toute leur force.
D’ailleurs, il est intéressant de constater que lorsque les médias s’interrogent sur les conventions constitutionnelles, ils s’adressent souvent à des politologues, davantage qu’à des juristes. Cette pratique confirme le caractère hybride (politico-juridique) de ces règles.
La nature particulière des conventions constitutionnelles leur confère deux caractéristiques qui les rendent difficiles à cerner:
- Il y a matière à débat sur leur véritable contenu (si les avocats sont incapables de s’entendre sur le sens des lois écrites, imaginez les non écrites!).
- Leur contenu n’est précisé ou clarifié que lorsqu’elles sont mises à l’épreuve. Tant que tout le monde semble suivre une règle, on ne débat pas de son contenu précis.
Et alors, au Québec?
Revenons à nos moutons: quelles sont les conventions constitutionnelles qui encadrent la nomination du premier ministre, dans notre système parlementaire?
Comme aucun parti politique n’avait jusqu’ici soutenu une personne autre que son chef pour devenir premier ministre, personne ne s’était posé la question, et les experts ne l’ont pas approfondie.
En faisant un peu de recherche, l’une des formulations que j’ai trouvées est la suivante:
Le [lieutenant-gouverneur] doit nommer comme premier ministre un chef de parti qui est assuré ou qui a de bonnes chances d’obtenir la majorité [à l’assemblée législative]1
Vous remarquerez qu’on ne parle pas du parti qui a obtenu le plus de sièges à la suite d’une élection générale, mais de quelqu’un «qui est assuré ou qui a de bonnes chances d’obtenir la majorité». La raison d’être de cette convention est de favoriser la nomination d’une personne qui sera capable d’obtenir la confiance de l’assemblée, élément essentiel de notre système parlementaire.
La plupart du temps, la personne la mieux placée sera le chef du parti qui a obtenu le plus de sièges. Toutefois, selon le jeu des alliances politiques, le chef d’un autre parti pourrait tout à fait être la personne qui a le plus de chances d’obtenir la majorité.
Autres possibilités

Prenons un cas où les partis qui sont arrivés deuxième et troisième en nombre de sièges se coalisent pour former une majorité (ce qui a failli se produire en décembre 2008 au Parlement fédéral). Le chef du parti arrivé troisième pourrait poser comme condition, pour appuyer l’autre, que la personne choisie comme premier ministre soit quelqu’un d’autre que le chef du parti arrivé deuxième.
Est-il nécessaire que ce soit un chef? Pour répondre à cette question, revenons à la raison d’être de la convention: nommer une personne qui est capable d’obtenir la confiance de l’assemblée.
Si une personne est soutenue par un parti pour devenir premier ministre, et ce parti fait obtient une majorité de sièges ou est appuyé par d’autres partis, il est difficile de croire qu’elle n’obtiendra pas la confiance de l’assemblée. La nomination de cette personne comme premier ministre serait donc tout à fait acceptable.
Alors, à quoi ça sert d’avoir des chefs de parti? C’est la question que nous aborderons dans le troisième billet de la série.